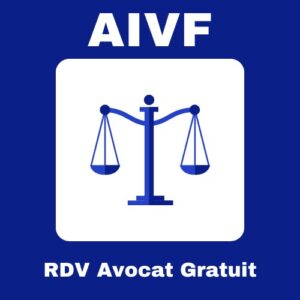❓ FAQ — Prétium Doloris : définition et explications
1. Qu’est-ce que le Prétium Doloris ?
2. Comment est-il évalué ?
3. Que prend en compte le prétium doloris ?
➡️ Les traitements médicaux et chirurgicaux subis
➡️ La gêne dans la vie quotidienne
➡️ La souffrance psychologique.
4. Quelle est l’échelle du prétium doloris ?
2/7 = léger
3/7 = modéré
4/7 = moyen
5/7 = assez important
6/7 = important
7/7 = très important.
5. Qui fixe le niveau du prétium doloris ?
6. Comment se traduit-il en indemnisation financière ?
7. Le prétium doloris est-il indépendant de l’AIPP/DFP ?
8. Peut-on contester l’évaluation du prétium doloris ?
9. Quelle est la durée prise en compte ?
10. Pourquoi est-il essentiel dans l’indemnisation ?
⚖️ Pretium doloris — Définition
Le pretium doloris correspond
aux souffrances physiques et psychiques
endurées par la victime
entre la survenance du dommage
et la date de consolidation.
Il constitue un poste de préjudice
extrapatrimonial temporaire
distinct des autres chefs de préjudice.
Dans la nomenclature Dintilhac,
le pretium doloris est désigné
sous l’appellation de souffrances endurées (SE).
Il vise à indemniser
les douleurs physiques,
la détresse morale,
les traitements invasifs
et les contraintes subies
avant la stabilisation de l’état de santé.
Le pretium doloris est évalué
par l’expert médical,
généralement sur une échelle de 1 à 7,
en fonction de l’intensité,
de la durée des douleurs
et des soins subis.
Son indemnisation relève
de l’appréciation souveraine des juges.
Le pretium doloris
ne se confond ni avec
le déficit fonctionnel temporaire,
ni avec le préjudice d’angoisse,
ni avec les souffrances permanentes.
Chaque poste doit être indemnisé distinctement,
afin d’éviter toute double réparation.