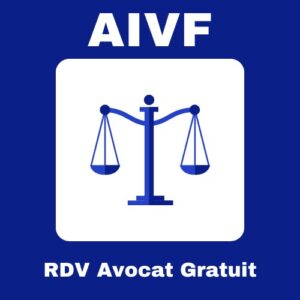❓ FAQ — AIPP/DFP et Stress post-traumatique (ESPT)
1. Que signifient AIPP et DFP ?
2. Un ESPT peut-il ouvrir droit à un AIPP/DFP ?
3. Comment le taux est-il évalué en cas d’ESPT ?
4. Qu’est-ce que la consolidation pour un ESPT ?
5. Quels justificatifs fournir pour un ESPT ?
6. Existe-t-il un barème automatique pour l’ESPT ?
7. Différence entre DFT (temporaire) et AIPP/DFP (permanent) ?
8. L’ESPT doit-il être diagnostiqué par un spécialiste ?
9. Peut-on contester le taux retenu ?
10. Quel impact sur l’indemnisation ?
11. Que faire en cas d’aggravation après consolidation ?
12. Pourquoi être assisté d’un avocat et d’un médecin-conseil ?
Aipp ou DFP Stress Post-traumatique, stress posttraumatique, syndromes neurologiques et psychiatriques
Essentiel à retenir
Définition de l’AIPP/DFP : L’AIPP ou DFP est une mesure de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel d’une personne suite à un accident. L’expertise médicale détermine le taux d’AIPP/DFP, qui n’a pas de maximum fixé en raison de la diversité des fonctions pouvant être atteintes.
Rôle des Experts Médicaux : Pour évaluer précisément l’AIPP/DFP, notamment dans les cas de stress post-traumatique ou de syndromes neurologiques, l’intervention de spécialistes comme les psychiatres est souvent nécessaire. Ils aident à préciser le diagnostic et à évaluer l’évolution prévisible de l’état de la victime.
Cas Particuliers : Les psychoses post-traumatiques sont rares et leur origine traumatique est généralement contestée. Cependant, un traumatisme peut déclencher ou révéler certaines conditions psychiatriques. De même, l’épilepsie post-traumatique nécessite une évaluation prudente et détaillée pour établir son imputabilité à l’accident.
Évaluation des Névroses et Stress Post-Traumatique : Les névroses post-traumatiques et le stress post-traumatique nécessitent une évaluation minutieuse de l’impact sur la vie quotidienne de la victime. Leur indemnisation prend en compte l’état antérieur, la permanence des troubles, et leur retentissement sur la vie de la victime, avec des taux d’AIPP/DFP variant généralement entre 5 et 20%.
Importance de l’Identification Précise des Syndromes : L’identification correcte des syndromes post-traumatiques est cruciale pour l’indemnisation adéquate du préjudice subi. Le stress post-traumatique, souvent sous-estimé, peut avoir un impact significatif sur la capacité de la victime à reprendre une vie normale. Une prise en charge précoce, associant psychothérapie et traitement médicamenteux, est essentielle pour la récupération de la victime.
À savoir : l’aipp correspond à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Aipp signifie Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique. C’est l’expertise médicale qui détermine le taux d’Aipp. Ce poste de préjudice s’appelle également DFP, c’est-à-dire Déficit Fonctionnel Permanent. L’importance des fonctions pouvant être atteintes ne permet pas de fixer un maximum. Le recours au spécialiste psychiatre s’avère souvent nécessaire, non pour se substituer à l’expert en évaluation du dommage corporel qui devra effectuer la synthèse et fixer un taux global, mais pour préciser un diagnostic, situer l’état par rapport à l’état antérieur du sujet et renseigner sur l’évolution prévisible.
Psychoses post-traumatiques
Les véritables psychoses post-traumatiques sont exceptionnelles. L’origine traumatique de la démence précoce (schizophrénie) est le plus souvent rejetée. Quant à la psychose maniaco-dépressive, son origine traumatique n’est jamais admise. Mais le traumatisme peut déclencher une poussée et parfois même révéler la maladie. L’expert doit s’attacher à dépister une éventuelle atteinte organique post-traumatique (hydrocéphalie, atrophie).
Démence post-traumatique
Le taux peut atteindre 100 % d’AIPP ou de DFP.
Épilepsie post-traumatique
La prudence s’impose avant d’affirmer le diagnostic d’épilepsie et de l’attribuer à un traumatisme crânio-encéphalique. Le diagnostic repose sur un élément unique, exclusivement clinique et rigoureusement indispensable, la survenue de crises indiscutables. Or, le plus souvent, il n’y a pas eu de témoin à formation médicale et certaines crises de nature hystérique sont occasionnellement de diagnostic difficile avec une authentique crise épileptique. L’imputabilité à un traumatisme nécessite qu’il y ait eu un traumatisme crânien d’une certaine importance, accompagné d’une perte de connaissance, et qu’il s’agisse d’une variété d’épilepsie pouvant avoir une origine traumatique. L’EEG est un élément de valeur, mais certaines épilepsies authentiques comportent un EEG normal. La majorité des épilepsies post-traumatiques se révèlent dans les trois ans qui suivent l’accident. Le taux d’AIPP ou de DFP ne peut s’évaluer qu’en tenant compte de multiples facteurs, aux premiers rangs desquels la fréquence des crises, l’importance du traitement anticonvulsant, la psychologie du sujet et sa façon d’assumer sa nouvelle condition, en n’oubliant pas que certaines activités sont interdites aux épileptiques, l’âge enfin. En lui-même, un EEG plus ou moins anormal ne justifie pas l’attribution d’une AIPP
– Crises localisées
suivant la fréquence 5 à 20 % d’AIPP ou de DFP
– Crises généralisées
– 1 crise isolée et non suivie d’un traitement ne justifie pas d’AIPP
– 1 ou 2 crises annuelles, avec traitement régulier, 15 à 20 % d’AIPP ou de DFP
– 1 ou 2 crises mensuelles permettant, sous certaines précautions, une activité normale, 20 à 30 % d’AIPP ou de DFP
– Crises plus fréquentes obligeant à réduire ou modifier les activités habituelles, 30 à 40 % d’AIPP ou de DFP
– Crises fréquentes interdisant une activité régulière, 40 à 50 % d’AIPP ou de DFP
Un barème peut difficilement rendre compte de ces divers éléments et c’est à l’expert qu’il revient finalement, tenant compte de son expérience et des données acquises en ce domaine, de déterminer l’importance du dommage subi, tant sur le plan fonctionnel que social. Certains syndromes neurologiques post-traumatiques tels que l’hydrocéphalie à pression normale, les fistules ostéodurales (hydrorrhées), les syndromes parkinsoniens, ne peuvent faire l’objet d’une indication chiffrée dans le cadre d’un barème. Ils nécessitent toujours l’avis d’un spécialiste et le taux doit tenir compte de la gêne fonctionnelle.
Névroses post-traumatiques
À base de réactions anxio-phobiques pouvant aller jusqu’à l’agoraphobie et parfois de réactions hystériques, elles réalisent souvent des formes masquées ou camouflées : réactions asthéno dépressives, algies polymorphes. Un traumatisme ne peut jamais, à lui seul, être responsable d’une structure ou personnalité hystérique. Si, après un accident, apparaissent des manifestations déficitaires telles qu’une paralysie, une cécité, dont la nature névrotique peut être affirmée, on ne peut considérer le traumatisme que comme ayant joué un rôle favorisant ou déclenchant de la manifestation hystérique, mais non comme responsable de la structure elle-même. Les symptômes spécifiques sont la labilité émotionnelle, le blocage des fonctions du « moi » (indifférence, inhibition de la libido) et les phénomènes répétitifs (ruminations mentales, cauchemars). L’organisation névrotique de la personnalité se révèle par une attitude ambigüe faite à la fois d’une dépendance à l’égard de l’entourage et d’une revendication. La note revendicatrice peut prendre le devant du tableau. L’évaluation de l’incapacité doit faire la part de l’état antérieur, apprécier le caractère permanent des troubles et tenir compte de leur retentissement sur la vie quotidienne de la victime, les taux pouvant varier habituellement entre 5 et 20 % d’AIPP ou de DFP. Le syndrome dépressif est relativement fréquent après un traumatisme. Il est le plus souvent résolutif après traitement.
Stress post-traumatique et traumatisme crânien
Article de Madame Anne Gometz
À travers une étude menée sur 1300 personnes victimes d’un traumatisme crânien, des chercheurs de l’INSERM ont montré que chez eux, le risque de développer un stress posttraumatique était multiplié par 4.5. Le stress posttraumatique est d’ailleurs très proche du syndrome post-commotionnel, lequel regroupe un ensemble de symptômes diffus, tels que des céphalées, des étourdissements, des vertiges… En effet, médecins et chercheurs insistent pour dire que le syndrome post-commotionnel ne serait qu’une partie du syndrome de stress posttraumatique (PTSD). S’il est intéressant de prendre le temps de décrire ces syndromes, c’est surtout parce que leur identification revêt une importance capitale en matière d’indemnisation du préjudice subi lorsqu’il fait suite à un accident. Le stress posttraumatique est souvent méconnu et sous-estimé. Mal invisible, il est un trouble anxieux caractérisé par des souvenirs répétitifs et persistants, des cauchemars liés à l’évènement traumatique, une hyper vigilance, un évitement de certaines situations ou objets, des troubles cognitifs (troubles de la concentration, troubles mnésiques), etc. Le PTSD est un syndrome particulièrement handicapant et invalidant. Les victimes qui en souffrent décrivent un état de stress permanent associé à une dépression et une difficulté à reprendre le cours de la vie habituel. Le mal-être est aussi non pris en compte par l’entourage, nous disent les victimes. Bien habituellement, autour d’eux, on les incite à « aller de l’avant », à « se secouer, se remettre en train », quand on ne les accuse pas tout simplement de simuler ou d’exagérer leur situation. Pourtant, il s’agit bien d’un mal réel qui impacte sérieusement le quotidien de celui qui en est victime. Il devient impossible de retourner travailler malgré les efforts et les diverses tentatives. La personne peut développer une culpabilité à vivre cet état, car de manière régulière, celui-ci a des répercussions sur la vie familiale et les membres proches de la victime. C’est la raison pour laquelle, ce trouble doit être pris en charge précocement. Il se traite par la psychothérapie et la prescription de psychotropes.
Retenir : Il convient d'être attentif au stress posttraumatique. Il est courant que ce poste soit sous évalué.
Exemples de questions de victimes sur le stress posttraumatique
Connaissez-vous un spécialiste après un accident de la route stress posttraumatique
Mon mari a eu un accident de route et depuis après réparation des séquelles physiques, il apparait de pire en pire un état de stress permanent et venons de consulter notre généraliste pour une dépression. Nous voudrions connaitre un spécialiste, avocat ou autre personne, qui pourrait nous aider à faire reconnaitre auprès des assurances son état.
Stress posttraumatique
J’ai pris connaissance de votre association en faisant des recherches sur Internet. J’ai été victime d’un accident de la route (choc frontal entre 2 voitures, j’étais assise à l’endroit du 2ᵉ impact) il y a 3 ans et demi de cela. J’ai eu beaucoup de chance, car je m’en suis sortie avec un traumatisme crânien très bénin. Je pensais que tout était réglé, mais j’ai commencé à faire des crises d’angoisse en tant que passagère qui se sont amenuisés, mais n’ont pas disparu, dès qu’il y a une intersection, je suis en stress et ma vue se déforme, je suis persuadée qu’on va me donner dedans. De même en tant que piétonne. J’essaie depuis avril de passer mon permis de conduire, mais au bout de 50h et après une tentative d’hypnose, je reste nerveuse, stressée et mon enseignante ne fait que de me crier dessus ce qui n’aide pas. Elle trouve mon stress ridicule. J’aimerais trouver un praticien spécialiste. Auriez-vous des conseils à me prodiguer ? Avez-vous déjà fait face à ce type de cas ?
⚖️ Jurisprudence — AIPP / DFP et stress post-traumatique
Le stress post-traumatique constitue une atteinte durable
aux fonctions psychiques de la victime.
Il relève du déficit fonctionnel permanent (DFP)
lorsqu’il entraîne une altération définitive
des capacités personnelles, sociales ou relationnelles.
Le DFP indemnise les séquelles psychiques permanentes,
indépendamment de toute incidence professionnelle.
Un trouble anxieux ou un syndrome de stress post-traumatique stabilisé
doit être pris en compte dans le taux de déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP (atteinte à l’intégrité physique et psychique)
constitue une terminologie antérieure à la nomenclature Dintilhac.
Désormais, ce poste correspond au déficit fonctionnel permanent,
qui inclut expressément les atteintes psychiques durables.
Un stress post-traumatique peut être consolidé
même en l’absence de guérison complète,
dès lors que les troubles psychiques sont stabilisés.
À compter de cette date, l’indemnisation relève du DFP
et non plus du déficit fonctionnel temporaire.
Le déficit fonctionnel permanent d’origine psychique
ne se confond ni avec les souffrances endurées,
ni avec le préjudice d’agrément ou le préjudice professionnel.
Chaque poste doit être indemnisé de manière autonome,
sur la base des conclusions médico-légales.