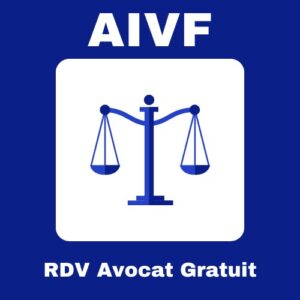❓ FAQ — Faute médicale & sanction au pénal : quelle différence avec la faute pénale ?
1. Définition : c’est quoi une faute médicale ?
2. Définition : c’est quoi une faute pénale ?
3. Différences clés entre faute médicale (civile) et faute pénale
Seuil de gravité : un simple manquement peut suffire au civil ; au pénal, il faut une faute pénale (imprudence/négligence caractérisée ou violation volontaire d’une règle).
Charge de la preuve : au civil, faute + lien avec le dommage ; au pénal, infraction caractérisée + lien causal.
Issue : dommages-intérêts (civil) vs peines (pénal) + éventuels dommages-intérêts si la victime est partie civile.
4. Exemples concrets
Pénal : anesthésie sans vérifications élémentaires → blessures involontaires ; abandon d’un patient en détresse → non-assistance ; divulgation de données → violation du secret.
5. Et l’aléa thérapeutique ?
6. Peut-on cumuler pénal, civil et disciplinaires ?
7. Rôle central de l’expertise médico-légale
8. Sanctions possibles au pénal vs réparations au civil
Civil/administratif : dommages-intérêts poste par poste (nomenclature Dintilhac), éventuellement rente (tierce personne/soins futurs).
9. Stratégie pour la victime : que privilégier ?
10. Qui peut m’aider ?
Faute médicale et sanction au pénal, la différence entre faute médicale et faite pénale
Essentiel à retenir
- Responsabilité Civile et Pénale : La responsabilité civile en médecine libérale et la responsabilité administrative dans le cadre public concernent la réparation des dommages (responsabilité réparatrice), tandis que la responsabilité pénale vise la sanction des fautes (responsabilité punitive), pouvant aboutir à une amende et/ou une peine d’emprisonnement.
- Cadre d’Exercice de la Médecine : Le mode d’exercice de la médecine (libéral ou public) détermine le type de responsabilité réparatrice applicable : civile pour le privé et administrative pour le public, reflétant le principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif.
- Procès Pénal et Réparation Pécuniaire : Lors d’un procès pénal, la victime peut demander une réparation pécuniaire pour son dommage, option non disponible devant une juridiction ordinale. La responsabilité pénale, individuelle et visant la punition, est régie par le code pénal et ses classifications d’infractions (contraventions, délits, crimes).
- Juridictions Répressives et Rôle du Parquet : Les infractions pénales sont jugées par les tribunaux de police, correctionnels, ou la cour d’assise. Le parquet, défendant l’ordre public, demande la sanction au nom de la société, tandis que les magistrats du siège prononcent la peine.
- Causes d’Irresponsabilité et Atténuation de la Responsabilité : Le code pénal prévoit des situations où la responsabilité pénale peut être atténuée ou exclue, telles que l’acte prescrit par la loi, agir sous autorité légitime, la contrainte, la légitime défense, ou les troubles psychiatriques affectant le discernement. Cependant, même en cas d’irresponsabilité pénale, la responsabilité civile demeure pour la réparation des dommages.
En résumé, la distinction entre faute médicale et sanction au pénal réside dans l’objectif de la responsabilité : réparatrice dans le civil et punitive dans le pénal, avec des procédures spécifiques selon le cadre d’exercice de la médecine et la nature de l’infraction.
La responsabilité est l’obligation morale ou juridique de répondre de ses actes
• dans la responsabilité juridique, on doit assumer ses fautes :
• soit en subissant une sanction
• soit en réparant un dommage.
On peut, de ce fait, distinguer :
• une responsabilité punitive
• une responsabilité réparatrice
En France, la médecine s’exerce :
• soit dans un cadre privé (médecine libérale)
• soit dans un cadre public (médecine de la fonction publique).
En médecine libérale, la responsabilité réparatrice est la responsabilité civile. En médecine de la fonction publique, la responsabilité réparatrice est la responsabilité administrative (principe de la séparation des pouvoirs : judiciaire et administratif).
Lors d’un procès pénal, la victime peut demander une réparation pécuniaire de son dommage (ce sont les dommages et intérêts) ce qu’elle ne peut faire devant une juridiction ordinale. La responsabilité punitive intéresse tous les citoyens
• Elle est toujours individuelle (c’est la personne elle-même qui est poursuivie).
• Le but d’une action en R.P. est la punition du coupable par une amende et/ou un emprisonnement.
• Les magistrats se réfèrent au code pénal qui est le catalogue limitatif des infractions légalement punissables et des sanctions correspondantes.
• Les infractions pénales sont classées suivant leur gravité croissante en contraventions (jugées en Tribunal de Police) en délits (jugés en Tribunal Correctionnel) et en crimes (jugés en Cour d’Assise).
• Le Tribunal de Police, le tribunal correctionnel et la Cour d’Assise sont des juridictions répressives. C’est le parquet ou ministère public qui défendant l’ordre public va demander la sanction au nom de la société. Les magistrats du parquet (Procureur de la République, Substituts du Procureur de la République et, en cour d’assise, avocat général) font partie de la « magistrature debout » car ils prononcent leur réquisitoire debout, ils sont amovibles parce qu’ils dépendent du « garde des sceaux » (i.e. ministre de la Justice). Mais ce sont les magistrats du siège (magistrature assise, inamovible) qui vont prononcer la peine. Ils peuvent siéger en juge unique ou en collège selon les cas, sauf en cour d’assise ou le président et ses assesseurs (deux ou plus) siègent avec un jury populaire (9 jurés en premier ressort, 12 jurés en appel).
Dans la responsabilité réparatrice, la réparation est pécuniaire.
La responsabilité punitive, qui peut être recherchée contre tout médecin quelque soit son mode d’exercice (libéral ou public), comprend :
-La responsabilité disciplinaire qui relève de la juridiction ordinale ; c’est la profession qui assure sa discipline interne.
-La responsabilité pénale qui n’existe que par référence aux seules infractions définies par le code pénal (contraventions, délits, crimes).
Cependant, il faut savoir que le code pénal prévoit des causes d’irresponsabilités et une atténuation de la responsabilité.
• Si l’acte est prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement (art 122-4 du CP). On rappelle que : les règlements émanent du pouvoir exécutif : décrets (Pdt de la République, 1er Ministre) arrêtés (ministres, préfets, maires) circulaires (pas de force probante pour le magistrat, mais s’appliquent de façon impérative dans le cadre hiérarchique). Les lois émanent du pouvoir législatif (Assemblée, Sénat).
• Si l’acte est commandé par l’autorité légitime (sauf si cet acte est manifestement illégal) (art 122-4 CP). • Si l’acte a été commis sous la contrainte (art 122-2 CP) ou en état de « légitime défense » (art 122-5 CP)
• Si l’acte a été commis pendant un trouble psychiatrique ayant aboli le discernement et le contrôle des actes de son auteur (art 122-1 CP).
Atténuation de la responsabilité Si, lors des faits, la personne était atteinte d’un trouble psychiatrique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, dans ce cas, elle demeure punissable, mais elle bénéficiera de « circonstances atténuantes ».
Même s’il est, au pénal, jugé irresponsable ou qu’il lui est reconnu une atténuation de sa responsabilité, celui qui a commis un acte dommageable reste civilement responsable, la victime pourra demander une réparation pécuniaire (dommages et intérêts ou indemnisation par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales si auteur non retrouvé ou insolvable, par le Fond de Garantie…).
Retenir : Pour l'indemnisation d'une erreur médicale, il n'est pas nécessaire qu'il y ait faute pénale. La faute pénale concerne les cas les plus graves de fautes.