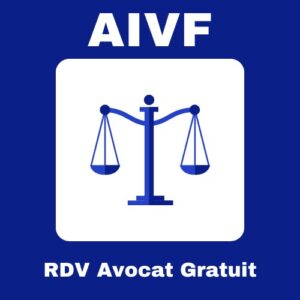❓ FAQ — Qu’est-ce que le déficit fonctionnel permanent (DFP) ?
1. Que signifie le déficit fonctionnel permanent (DFP) ?
2. Quelle est la différence entre DFP et incapacité permanente partielle (IPP) ?
L’IPP est une notion proche, employée par certains barèmes.
Tous deux visent à mesurer la perte de capacités de la victime.
3. Quand peut-on évaluer le DFP ?
4. Comment est-il mesuré ?
5. Quels éléments sont pris en compte ?
6. Quelle est son importance pour l’indemnisation ?
Plus le pourcentage est élevé, plus la réparation financière accordée à la victime est importante.
7. Le DFP inclut-il la souffrance psychologique ?
8. Peut-on contester le pourcentage fixé ?
9. Quelle est la place du DFP dans la nomenclature Dintilhac ?
Il vise à réparer la perte de qualité de vie et les atteintes aux fonctions essentielles de la personne.
10. Comment être sûr d’obtenir une juste indemnisation ?
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition, enjeux et indemnisations
Le déficit fonctionnel permanent, abrégé en DFP, correspond à l’altération durable, voire définitive, des capacités physiques, mentales ou sensorielles d’une personne à la suite d’un accident ou d’une maladie. Cette notion entre en jeu une fois que l’état de santé de la victime est considéré comme consolidé, c’est-à-dire stabilisé, même si des séquelles subsistent. Le DFP constitue alors un préjudice personnel et autonome, qui donne droit à une indemnisation distincte.
1. Comprendre la consolidation et le caractère permanent
La consolidation ne signifie pas que la personne est guérie, mais que son état de santé ne connaîtra plus d’évolution notable. À partir de ce moment, les atteintes qui demeurent deviennent des séquelles, et leur impact sur la vie quotidienne peut être estimé. C’est ce que reflète le DFP : la perte d’intégrité physique et psychique, qui touche durablement l’autonomie, le confort de vie et parfois la dignité même.
2. Le rôle de l’expertise médicale
Le taux de DFP est généralement fixé lors d’une expertise médicale, réalisée par un médecin expert. Celui-ci évalue les conséquences des séquelles sur les activités quotidiennes, en tenant compte de différents facteurs : douleur persistante, perte de mobilité, troubles sensoriels ou cognitifs, etc. Le taux est exprimé en pourcentage, de 1 % à 100 %, et peut être contesté en cas de désaccord.
3. Une indemnité pour atteinte à la personne
Le DFP n’a pas vocation à compenser une perte de revenus (contrairement aux préjudices professionnels). Il rémunère l’atteinte à l’intégrité corporelle elle-même. C’est une forme de réparation du dommage moral et existentiel causé par le handicap permanent. À ce titre, il entre dans la nomenclature des préjudices indemnisables (barème Dintilhac).
4. Quelques exemples concrets
- Une perte partielle de l’usage d’un bras peut entraîner un DFP de 15 %.
- Une paraplégie équivaudra souvent à un DFP proche de 80 %.
- Des douleurs chroniques lombaires post-traumatiques peuvent être évaluées à 5 ou 10 %.
5. Barèmes utilisés pour le calcul
Il n’existe pas de barème unique. Les juridictions se réfèrent à plusieurs sources :
- Le barème indicatif de la Cour d’appel de Paris.
- Les barèmes médicaux des compagnies d’assurance.
- Le barème Dintilhac, qui structure les postes de préjudices.
Le montant d’indemnisation variera selon l’âge de la victime, le taux retenu et la gravité de l’atteinte. Par exemple, un DFP de 10 % à 35 ans pourra générer une indemnité de 15 000 à 25 000 €.
6. Faire valoir ses droits
Il est essentiel d’être bien accompagné dans les démarches :
- Un médecin conseil peut réévaluer le taux si besoin.
- Un avocat en dommage corporel peut contester une expertise jugée défavorable.
- Il est possible de saisir un juge ou demander une contre-expertise.
Conclusion
Le déficit fonctionnel permanent est une notion complexe mais centrale pour les victimes d’accident ou d’agression. Sa bonne reconnaissance conditionne l’accès à une indemnité juste et complète. Connaître ses droits, s’entourer de professionnels et faire valoir ses séquelles avec précision est donc une étape décisive dans la réparation du dommage subi.